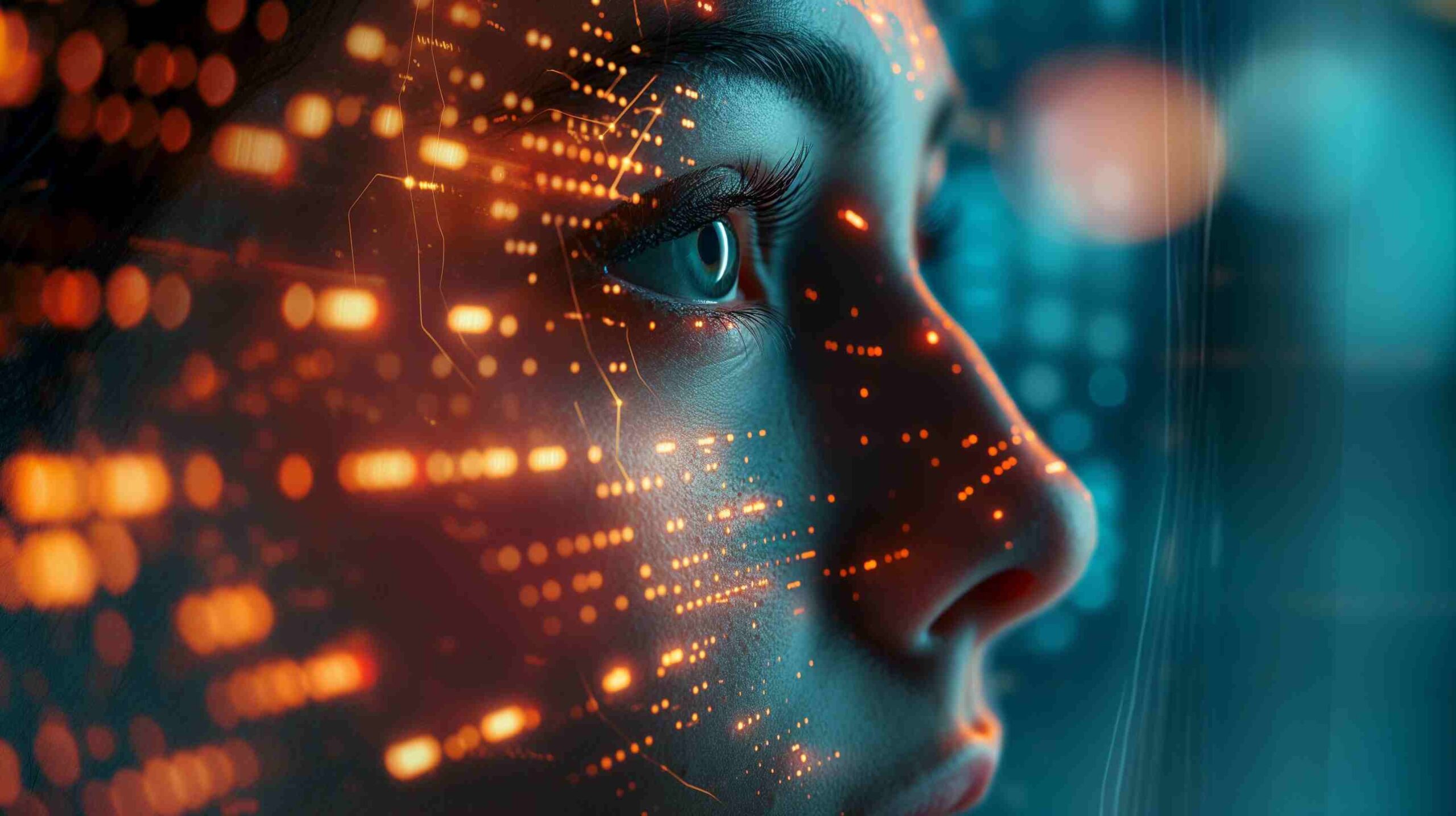Nous recherchons et sélectionnons les experts les plus adaptés à vos besoins.
Prestations intellectuelles : quel est l’ impact du cadre réglementaire national et européen sur les achats ?

Les achats de prestations intellectuelles (PI) connaissent une croissance soutenue ces dernières années, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Pour les entreprises du secteur privé, le recours à des talents externes permet de pallier l’absence de compétences en interne et de rester compétitif dans un environnement marqué par la rareté de certaines expertises.
Cette solution offre également une flexibilité très recherchée par les entreprises puisque celles-ci peuvent ajuster la durée des missions selon leurs besoins réels, tout en limitant les coûts et les engagements d’un recrutement classique.
Le secteur public recourt lui aussi aux achats de prestations intellectuelles pour bénéficier ponctuellement d’expertises rares, par exemple dans le cadre d’études, de projets de transformation digitale ou de mise en conformité réglementaire. À titre d’illustration, France Télévisions consacre chaque année près de 70 millions d’euros à ces achats, hors IT, soit environ 10% de ses achats hors production, avec une part significative dédiée au conseil en stratégie ou à la conduite du changement.
Le phénomène s’accélère puisque plus de 30 % des appels d’offres publiés sur les principales plateformes en 2024 concernent désormais des compétences hors IT et ingénierie (Observatoire de la Commande Publique Marco – AGYSOFT, « Chiffres 2023-2024 »).
Ainsi, on observe une réelle diversification des missions et une fragmentation du marché vers des expertises ultra spécialisées. Cette tendance oblige les entreprises à recourir davantage à des plateformes ou à des cabinets spécialisés pour identifier et contractualiser avec les meilleurs talents.
Or, la complexité croissante des achats de prestations intellectuelles appelle un encadrement juridique plus rigoureux, afin de limiter les nombreux risques liés à ce type de relations contractuelles. C’est dans cet objectif que la France et l’Union européenne ont progressivement renforcé leur cadre législatif.
Dans cet article nous allons voir comment les évolutions réglementaires, nationales et européennes, redéfinissent aujourd’hui les pratiques d’achat de prestations intellectuelles, tant dans le secteur public que privé.

Achat de prestations intellectuelles : comprendre l’influence du cadre réglementaire public sur les acheteurs du secteur privé
Le secteur public bénéficie d’un encadrement réglementaire strict en matière d’achat de prestations intellectuelles, notamment à travers les dispositions du Code de la commande publique.
Au contraire, le secteur privé ne dispose pas d’un cadre officiel dédié pour ces achats puisqu’ils relèvent principalement du droit commun des contrats.
Face à l’absence d’un cadre juridique propre au secteur privé, les entreprises tendent à s’inspirer des normes de la commande publique comme référence pour fiabiliser leurs contrats et formaliser leurs achats de prestations intellectuelles.
Cette proximité s’explique aussi par le fait que de nombreuses entreprises publiques collaborent étroitement avec des acteurs privés, et inversement, rendant la frontière entre secteur public et secteur privé plus ténue en matière d’achat de PI.
Le cadre officiel, du secteur public, exerce ainsi une influence indirecte mais réelle sur les acteurs privés.
Achat PI : zoom sur les normes applicables dans le secteur public et privé
En France, le secteur public est soumis aux règles du Code de la commande publique ainsi qu’au CCAG-PI (Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Prestations Intellectuelles). Ce dernier constitue un document de référence standardisé qui encadre la passation et l’exécution des contrats de prestations intellectuelles. Il définit notamment les missions, les conditions de paiement, la gestion des droits de propriété intellectuelle, ainsi que les modalités de contrôle de l’exécution.
L’objectif est d’assurer une plus grande transparence, une sécurité juridique renforcée et une homogénéité des pratiques au sein des marchés publics.
Dans le secteur privé, les achats de prestations intellectuelles sont régis par le droit commun des contrats (Code civil) et le droit commercial. Il n’existe donc pas de règles spécifiques imposées par la loi.
Les entreprises doivent veiller à bien définir la nature de la prestation, à préciser les modalités de cession des droits de propriété intellectuelle, et à éviter certains risques juridiques tels que le prêt illicite de main-d’œuvre ainsi que le délit de marchandage,
Rappelons que le prêt illicite de main-d’œuvre est la mise à disposition de salariés en entreprise en dehors du cadre légal (articles L8241-1 et L8241-2 du Code du travail) alors que le délit de marchandage consiste à recruter ou à louer de la main-d’œuvre à but lucratif sans respecter les règles relatives au travail temporaire (articles L8251-1 et L8251-2 du Code du travail).
Ainsi, les directions achats du secteur privé sont libres d’adapter leurs contrats selon leurs besoins. Le CCAG-PI peut leur servir de référence, mais ses clauses doivent être adaptées au cadre juridique applicable au secteur privé.
Obligations transversales des entreprises : critères ESG, facturation électronique et devoir de vigilance
Certaines obligations “ transversales ” s’appliquent à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur ou la nature de leurs achats. Parmi elles, la prise en compte des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), l’obligation de facturation électronique et le devoir de vigilance jouent un rôle essentiel.
Les critères ESG, visent à intégrer dans les décisions d’achat des exigences relatives à la protection de l’environnement, au respect des conditions sociales (comme les droits humains) et à une gouvernance responsable des entreprises. Ces critères occupent aujourd’hui une place majeure, notamment sous l’impulsion de la loi Climat et Résilience (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021), qui lutte contre le dérèglement climatique, ainsi que du Plan National pour des Achats Durables (PNAD).
S’agissant de l’obligation de facturation électronique, elle a été instaurée par la loi du 29 décembre 2020 relative à la lutte contre la fraude à la TVA (loi n° 2020-1721) et deviendra obligatoire pour toutes les transactions inter-entreprises à partir de septembre 2026. Cette mesure repose sur la norme européenne EN 16931 et le règlement (UE) 2025/1197 et vise à moderniser les processus, réduire la fraude et à assurer une meilleure traçabilité.
Enfin, la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 a instauré le devoir de vigilance, qui impose aux grandes entreprises et donneurs d’ordre l’obligation de mettre en place un plan visant à identifier, prévenir et atténuer les risques graves pouvant affecter les droits humains, la santé, la sécurité ou l’environnement dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, y compris chez les filiales, sous-traitants et fournisseurs.
Ce devoir s’applique également aux prestations intellectuelles, telles que les missions de conseil, d’ingénierie ou d’audit, dès lors que ces services peuvent entraîner des risques dans ces domaines.
A titre d’exemple, un cabinet de conseil en ressources humaines qui accompagne un plan de restructuration doit veiller à ne pas porter atteinte aux droits des salariés. De même, un prestataire chargé d’audits de conformité doit garantir la fiabilité de ses analyses pour éviter des risques réglementaires ou environnementaux. Enfin, les études d’impact réalisées par des sociétés d’ingénierie peuvent avoir un effet direct sur la protection de l’environnement et doivent donc être prises en compte dans le plan de vigilance.
Intégrer ces prestations intellectuelles dans la démarche de vigilance permet aux entreprises de mieux protéger les personnes et l’environnement tout au long de leurs activités, sous peine de sanctions civiles et pénales en cas de manquement.
Achat PI et souveraineté économique : le rôle clé de la fonction Achats
En matière de prestations intellectuelles (PI), la question de la souveraineté économique est désormais au premier plan.
En effet, le domaine des prestations intellectuelles s’étend constamment à des secteurs à haute sensibilité, couvrant aujourd’hui des domaines tels que le numérique, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, les biotechnologies, ainsi que les systèmes critiques de défense.
Ces filières comportent des risques accrus liés à la sécurisation des données, à la maîtrise des innovations et au contrôle stratégique des chaînes d’approvisionnement.
Dans ce contexte, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) 2025/1197 qui fixe des restrictions limitant le recours à des prestataires extra-européens dans les secteurs sensibles.
Si la mesure cible prioritairement les marchés publics, elle incite aussi les entreprises privées à réorienter leurs stratégies d’achat vers le sourcing intra-européen pour renforcer leur résilience, garantir la conformité réglementaire et protéger les intérêts économiques européens.
Cette dynamique réglementaire à l’échelle européenne démontre comment les choix faits dans le secteur public influencent directement les pratiques d’achat du secteur privé.
Les Directions Achats sont donc des actrices centrales, devant concilier compétitivité, réglementation et souveraineté économique dans un contexte de mondialisation et d’accélération technologique.
Prestations intellectuelles et plateformes : une responsabilité accrue des parties prenantes
Les plateformes numériques sont au cœur des échanges ces dernières années, facilitant la mise en relation entre donneurs d’ordre et prestataires spécialisés, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée.
Elles permettent aux entreprises de mobiliser rapidement des profils spécialisés dans le cadre de prestations intellectuelles qui représentent aujourd’hui une part significative de l’activité sur ces plateformes : secteurs du conseil, de l’IT, du marketing, consultants, développeurs, analystes, designers, rédacteurs techniques, etc.
Bien que très prisées par les recruteurs pour leur accès rapide à une expertise externe, la croissance rapide des plateformes a fait émerger de nouvelles problématiques juridiques et sociales.
Parmi celles-ci figurent la confusion des statuts, la précarisation des travailleurs indépendants, l’asymétrie entre donneurs d’ordre et prestataires, ainsi que le recours abusif à la sous-traitance déguisée.
Aussi, l’Union européenne est intervenue pour prévenir les risques liés à l’utilisation de ces plateformes depuis novembre 2024, via la directive (UE) 2024/2831 relative à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs des plateformes numériques, une avancée majeure pour la régulation des freelances et autres prestataires opérant via ces plateformes.
Cette directive instaure une présomption légale simple de salariat ce qui signifie que par défaut, un travailleur par plateforme est considéré comme salarié, sauf preuve contraire. Un tournant majeur puisque, cela modifie le statut juridique normalement associé aux freelances dans l’économie numérique.
Sont concernés tous les individus effectuant un travail via une plateforme de travail numérique, notamment les livreurs, chauffeurs VTC, travailleurs à la demande, ainsi que les prestataires de services intellectuels indépendants utilisant ces plateformes.
Ces plateformes doivent garantir aux travailleurs les droits sociaux associés au salariat. La directive impose en effet des règles strictes de transparence et de supervision humaine sur les algorithmes utilisés pour gérer les tâches et les conditions de travail, ainsi qu’une meilleure protection sociale et la protection des données personnelles.
Par conséquent, les entreprises privées ayant recours à des prestataires via plateformes doivent s’assurer que ces dernières respectent bien ces règles, ce qui implique une responsabilité nouvelle pour les donneurs d’ordre dans la chaîne d’approvisionnement.
Ainsi, cette réglementation s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur privé, dès lors que les plateformes numériques sont utilisées pour l’achat de prestations intellectuelles.
L’entité qui utilise la plateforme a la responsabilité de s’assurer que celle-ci respecte ce cadre juridique strict. Si les freelances bénéficient d’une meilleure protection, les obligations incombent directement aux plateformes et à leurs clients, c’est-à-dire aux donneurs d’ordre.
Cette directive doit être transposée en droit national d’ici fin 2026.