Nous recherchons et sélectionnons les experts les plus adaptés à vos besoins.
Réussir l’achat de prestations intellectuelles : erreurs à éviter et bonnes pratiques

La demande de prestations intellectuelles des entreprises a fortement augmenté ces dernières années, portée par un environnement en constante évolution et une concurrence croissante qui redéfinissent les règles du jeu. Ces prestations, qui regroupent les services d’experts et leur savoir-faire dans des domaines variés, sont devenues un levier stratégique pour les entreprises souhaitant innover, s’adapter aux nouvelles réalités du marché et rester compétitives. Elles s’étendent sur des secteurs aussi divers que la technologie, la santé, l’éducation, le commerce, l’industrie, et bien d’autres encore.
La mondialisation, la complexité accrue des marchés, la transformation numérique et l’essor de l’intelligence artificielle (IA) imposent de nouvelles exigences aux entreprises qui doivent continuellement s’adapter pour rester compétitives.
L’externalisation des prestations intellectuelles s’impose comme une solution privilégiée qui offre aussi des avantages aux entreprises : accès à des compétences spécialisées, réduction des coûts fixes liés à l’embauche de personnel permanent et une flexibilité précieuse pour s’adapter rapidement aux évolutions du marché.
Le processus d’achat de prestations intellectuelles n’est cependant pas exempt de difficultés et d’erreurs, notamment en termes de dépassements budgétaires, de retards dans la livraison des services ou de prestations non conformes aux attentes, qui peuvent coûter très cher aux entreprises. Il est donc primordial de faire preuve de vigilance et de rigueur pour sécuriser ces acquisitions stratégiques.
Comment sécuriser l’achat de prestation intellectuelle ? Nous allons voir dans cet article les principales erreurs à éviter pour une acquisition sécurisée et efficace de ces services clés.

Erreur n°1 : ne pas impliquer les acteurs internes
La première erreur consiste à ne pas évaluer précisément les besoins en prestations intellectuelles, faute d’impliquer suffisamment les acteurs internes.
En effet, les services internes tels que la Direction générale, les ressources humaines, les bureaux d’études ou la DSI (Direction des Systèmes d’Information) disposent souvent d’une expérience directe des prestations de conseil ou de services immatériels. Leur retour d’expérience et leur connaissance opérationnelle sont centraux pour identifier les véritables attentes, éviter de reproduire les erreurs passées et mieux orienter les décisions d’achat futures.
Une gestion optimale des achats intellectuels repose donc sur l’engagement des acteurs internes dès l’étape d’identification des besoins. Cela permet de clarifier les objectifs, de définir précisément les services requis et d’aligner les projets sur les priorités stratégiques de l’entreprise.
Aussi, la prise en compte des représentants des différents départements apporte de nombreux bénéfices dans le processus d’achat de prestations intellectuelles, à savoir :
- La détection des besoins transversaux, évitant les redondances et rationalisant les achats,
- La vision globale des compétences nécessaires, facilitant une stratégie d’achat plus cohérente,
- L’optimisation du panel de fournisseurs, favorisant la concentration sur les meilleurs prestataires, des négociations plus efficaces et des économies d’échelle.
Une approche collaborative renforce ainsi la qualité des achats tout en réduisant les erreurs liées à des prestations intellectuelles mal définies.
Erreur n° 2 : ne pas cerner les priorités stratégiques de l’entreprise
Avant de prendre toute décision d’achat, il est central de bien comprendre les priorités stratégiques de l’entreprise c’est-à-dire :
- La vision à long terme de l’entreprise (croissance, innovation, expansion géographique, etc.) ;
- Les objectifs de transformation (numérique, organisationnelle, etc.) ;
- Les besoins en matière de compétitivité (amélioration de l’efficacité, réduction des coûts, différenciation sur le marché) ;
- Les domaines où l’entreprise doit renforcer ses compétences (technologie, marketing, Recherche & Développement etc.).
Une fois ces priorités stratégiques identifiées, il devient possible de sélectionner des prestations intellectuelles qui y correspondent directement et soutiennent les priorités stratégiques de l’entreprise.
Ainsi, si l’objectif est d’améliorer la compétitivité, les achats peuvent porter sur des services de conseil stratégique, d’optimisation des processus ou de formation en gestion de la performance.
Dans le cadre d’une transformation numérique, des prestations en cybersécurité, gestion de données ou développement logiciel peuvent s’avérer prioritaires. Pour une stratégie axée sur l’innovation, des services en recherche et développement ou intelligence artificielle peuvent être nécessaires.
Chaque prestation achetée doit apporter une réelle valeur ajoutée en lien avec l’objectif stratégique de l’entreprise.
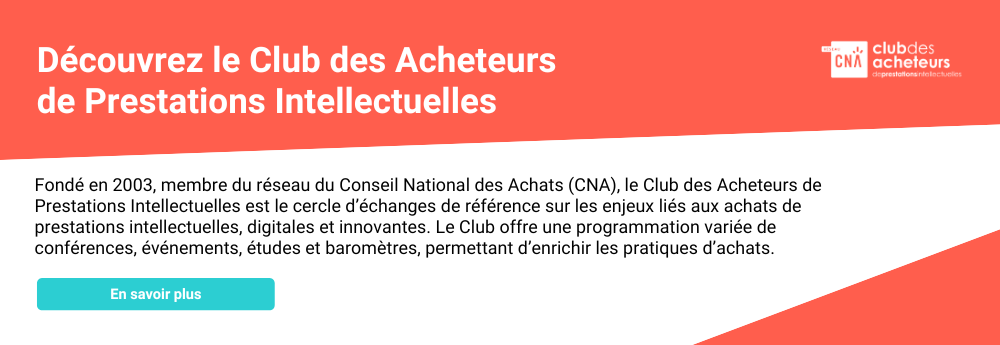
Erreur n°3 : choisir un prestataire sans vérifier son expertise et sa capacité à soutenir la stratégie de l’entreprise
Une autre erreur possible est de négliger les compétences et l’expérience du prestataire avant de le sélectionner.
Il est primordial de choisir un fournisseur après avoir évalué sa capacité à répondre précisément aux besoins de l’entreprise, sous peine de faire face à des déceptions, des retards et des résultats en deçà des attentes.
Il est important d’examiner le parcours professionnel du prestataire, ainsi que les types de projets sur lesquels il a travaillé dans le passé avant de le sélectionner.
Lui demander de réaliser un test sur une mission permet d’évaluer directement ses compétences en situation réelle.
Enfin, solliciter des références auprès de clients précédents est une façon fiable d’obtenir un retour d’expérience objectif sur la qualité de son travail et sa fiabilité.
Erreur n°4 : sous-estimer la précision du cahier des charges
Un appel d’offres découle directement de la qualité du cahier des charges. Si ce dernier est mal conçu, il peut devenir la première cause d’échec des prestations sous-traitées, entraînant des retards, des coûts imprévus et des résultats insatisfaisants.
Les entreprises ont donc tout intérêt à éviter de rédiger un cahier des charges flou ou imprécis, ne définissant pas clairement les attentes et les objectifs du projet.
Une mauvaise formulation des besoins a des conséquences graves sur la qualité de la prestation.
Si le cahier des charges est trop vague ou incomplet, il ne fournira pas aux prestataires les informations nécessaires pour proposer des solutions adaptées.
Aussi, le cahier des charges devrait toujours préciser :
- les dates de début et de fin,
- le taux journalier,
- les déplacements à prévoir le cas échéant,
- les critères d’évaluation précis : indicateurs clairs permettant de comparer et de sélectionner les offres les plus adaptées aux attentes et aux objectifs fixés (qualité technique, délais, les coûts, pertinence des solutions proposées etc).
Si ces critères ne sont pas clairement définis, la sélection du prestataire devient complexe et subjective. Cela peut conduire à la sélection d’une offre qui ne correspond pas réellement aux besoins de l’entreprise, ou à des difficultés lors de l’analyse des propositions.
Par ailleurs, les sections techniques, qui précisent les compétences métiers attendues du cahier des charges, doivent être rédigées en collaboration avec des experts du domaine concerné comme un expert en intelligence artificielle pour un projet de machine learning ou un consultant en cybersécurité pour la mise en place de solutions de protection des données.
Erreur n°5 : sous-estimer l’aspect juridique du processus d’achat de prestations intellectuelles
Le contrat de prestation de service entre l’entreprise et le prestataire doit être rédigé afin d’assurer la protection des intérêts des deux parties.
Dans le cadre des prestations intellectuelles, les droits de propriété intellectuelle sont fondamentaux et doivent être spécifiquement définis.
La contractualisation de ces droits est indispensable pour préciser les modalités de :
- Reproduction : définir si le travail peut être copié et, le cas échéant, dans quelles conditions.
- Utilisation : clarifier dans quels contextes le travail pourra être utilisé, notamment si des restrictions géographiques ou sectorielles s’appliquent.
- Représentation : préciser si le travail peut être présenté publiquement, dans quel cadre et sous quelles conditions.
- Diffusion : déterminer si et comment le travail peut être distribué à d’autres parties, par exemple à travers des médias ou des canaux de distribution.
- Modification : établir si des modifications ou adaptations du travail original sont permises et dans quelles limites.
- Exploitation : spécifier les droits économiques liés à l’exploitation du travail, notamment la possibilité d’en tirer des bénéfices.
- Exclusivité : déterminer si l’entreprise dispose de droits exclusifs sur le travail ou si le prestataire peut proposer des solutions similaires à d’autres clients.
- Durée : définir la période pendant laquelle les droits de propriété intellectuelle sont accordés et toute prolongation éventuelle.
- Périmètre géographique : préciser les zones géographiques où les droits d’utilisation ou d’exploitation sont valides.
En rédigeant ces éléments de manière claire et détaillée, l’entreprise et le prestataire s’assurent d’éviter toute ambiguïté ou conflit ultérieur concernant l’utilisation du travail fourni.
Erreur n°6 : confondre les freelances et les employés de l’entreprise
Lorsque l’entreprise sollicite des prestataires de prestations intellectuelles (PI), elle doit impérativement respecter les règles légales qui distinguent les freelances des salariés.
L’entreprise donneuse d’ordre doit en effet veiller à ne pas imposer de conditions de travail similaires à celles d’un salarié, telles que des horaires fixes, une hiérarchie stricte ou des obligations de présence sur site. Les freelances doivent conserver leur autonomie et avoir la liberté de choisir leurs outils, méthodes et horaires de travail.
Ignorer cette distinction peut entraîner une requalification du contrat de prestation intellectuelle en contrat de travail, ce qui peut avoir des conséquences juridiques et fiscales lourdes pour l’entreprise.
De plus, l’entreprise doit être particulièrement attentive au délit de marchandage et au prêt de main-d’œuvre illicite, qui désignent la mise à disposition illégale de travailleurs par une entreprise. Ces délits peuvent entraîner des sanctions juridiques sévères : amendes, des pénalités financières et des poursuites judiciaires.
Pour prévenir ces erreurs, l’entreprise doit clarifier les attentes et les responsabilités de chaque partie dans un contrat de prestation afin d’éviter toute ambiguïté concernant le statut du prestataire.
Il est aussi indispensable de s’assurer que les freelances sont engagés pour des missions précises et ne sont pas affectés à d’autres entreprises conformément à la loi.
En conclusion, la diversité des prestations intellectuelles ne cesse d’augmenter et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. Grâce à l’externalisation des prestations intellectuelles, les entreprises peuvent se concentrer sur leur cœur de métier tout en bénéficiant de l’expertise nécessaire pour relever les défis complexes du marché.
La vigilance demeure car une mauvaise gestion de l’achat de prestations intellectuelles peut impacter non seulement la qualité des services fournis, mais également nuire à la réputation et à la performance globale de l’entreprise.
Textes de références :
- article L8241-1 du Code du travail
- article L.8234-1 du Code du travail
- article L1251-23 Code du travail
- article L. 8241-2 du Code du travail















